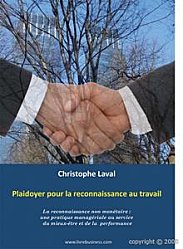
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’ouvrage de Christophe Laval intitulé Plaidoyer pour la reconnaissance au travail (sous titre : La reconnaissance non monétaire : une pratique managériale au service du mieux-être et de la performance), qui vient de paraître. S’agissant d’un sujet qui me tient à coeur (cf. ce billet que j’avais rédigé précédemment), j’ai interviewé son auteur.
Vous écrivez que la France est très en retard sur les questions de la reconnaissance non monétaire au travail. Quelles sont cependant les entreprises et/ou les pratiques qui vous semblent intéressantes à étudier et à diffuser ?
Christophe Laval : Je pense effectivement que la reconnaissance au travail est encore loin d’être rentrée dans les mœurs de toutes les entreprises. Elle est souvent perçue par le management comme relevant de la seule psychologie ou de la philosophie, ou comme une perte de temps (surtout en temps de crise) alors qu’il s’agit d’une véritable pratique managériale au service du mieux-être des salariés et de la performance des entreprises. Au delà des principes d’humanisme et de morale, on parle ici d’efficacité générée par l’engagement de tous, d’intérêts mutuels et de bénéfices réciproques.
Certaines sociétés comme Redcats (groupe PPR), Sodexo ou Fedex France ont d’ailleurs déjà intégré cela dans leur politique d’entreprise. Et ce qui est intéressant, c’est qu’il ne s’agit pas d’un programme « à part » mais au contraire d’un programme totalement aligné avec le plan stratégique et pris en compte dans les objectifs opérationnels.
A partir de votre expérience et de vos observations, les hommes et les femmes ont-ils les mêmes besoins de reconnaissance ?
C.L. : Je ne crois pas que le fait d’être un homme ou une femme soit l’élément le plus important. En revanche, pour être adéquate, la reconnaissance doit être personnalisée. Chacun a sa propre histoire, ses propres valeurs et convictions, ses propres motivations et sa propre personnalité.
Il faut donc connaître pour reconnaître. Manifester de la reconnaissance nécessite de s‘adapter aux attentes des salariés mais également de « mixer » les types, pratiques et fréquences en fonction de la culture de son entreprise.
La productivité en France est l’une des meilleures en monde, dit-on, pourtant les politiques de reconnaissance y sont parmi les plus faibles. Comment expliquer ce paradoxe ? N’est-ce pas un argument pour les personnes qui pensent que la reconnaissance n’est pas si importante que cela à mettre en oeuvre ?
C.L. : On pourrait de la même façon dire qu’en temps de crise, ce qui importe, c’est de réduire les coûts, de renforcer les procédures, le reporting et les indicateurs…et que tout le reste attendra la sortie de crise ! Mais quelles seront alors les entreprises les mieux armées ?
Incontestablement celles qui auront fait en sorte de permettre à leurs collaborateurs de travailler au maximum de leur potentiel, qui auront réduit leurs coûts cachés ou indirects comme le temps gaspillé, l’abstentéisme ou le turnover. Je rajouterai que l’on se trouve aujourd’hui face à une crise de confiance généralisée et qu’il est grand temps, comme l’a dit le Président de la République dans ses vœux, de « redonner à la dimension humaine toute sa place dans l’économie ». Or, confiance et reconnaissance sont indissociablement liées.
Peut-on évaluer le coût de la non-reconnaissance ? Et celui d’une politique managériale de reconnaissance ?
C.L. : Bien sûr. Non seulement on le peut, mais on doit le faire. Quand on met en place une politique managériale de reconnaissance, au même titre que n’importe quel investissement, on doit calculer un ROI (Return on Investment) en rapportant les gains générés au coût du programme.
Quand au coût de la non-reconnaissance pour la collectivité ou pour les entreprises, il est colossal : stress et non reconnaissance sont deux maux intimement liés. L’INRS a chiffré à environ 1 milliard d’euros l’impact direct du stress sur la compétitivité des entreprises. Le coût du turnover, quant à lui, se chiffre, pour chaque grande entreprise, à plusieurs millions d’euros. Rajoutons à cela que le manque de motivation des équipes peut générer une augmentation du temps improductif ou de l’absentéisme, et l’on voit que la reconnaissance est un véritable enjeu de compétitivité.
Quel est le frein culturel le plus difficile à dépasser pour mettre en place une vraie politique de reconnaissance ?
C.L. : Il n’y pas de réponse générale car tout dépend des entreprises, de leur vision, de leurs valeurs et des convictions de leurs dirigeants. Je pense néanmoins que la culture du contrôle et de la sanction qui prédomine encore dans beaucoup d’entreprises est « LE véritable frein ». A force d’entendre parler des trains qui arrivent en retard mais jamais de ceux qui sont à l’heure – en d’autres termes de n’être jamais félicité pour avoir fait du bon travail, mais critiqué ou sanctionné pour avoir fait une erreur – le salarié finira par conclure « que ne pas avoir de nouvelles de la part de son chef est une bonne nouvelle »… Est-ce la meilleure façon de générer de la confiance et du sens ?
Vous écrivez qu’il faut « latiniser les pratiques américaines » ? Pouvez-vous expliquer concrètement ce que cela signifie ?
C.L. : Cela signifie qu’il ne faut pas faire du « copier/coller » des pratiques américaines mais les customiser intelligemment en les adaptant à notre culture pour les rendre acceptables par nos salariés. Je prends un exemple : réunir régulièrement l’ensemble des collaborateurs de son service pour féliciter l’un d’entre eux qui a eu un comportement remarquable et le faire applaudir par l’équipe, est une pratique courante aux Etats-Unis… difficilement applicable en France, sauf à faire passer le salarié en question pour le « chouchou » du chef et à générer de la jalousie. En revanche, voir le collaborateur en tête à tête en lui faisant exactement les mêmes félicitations est tout à fait acceptable en France… Les Français ont autant besoin de reconnaissance que les Américains, mais la façon de dispenser cette reconnaissance et ses conséquences sont extrêmement différentes. Il est d’ailleurs intéressant de s’inspirer des pratiques québécoises car si les Québécois sont incontestablement nord-américains, ils combinent pragmatisme et sens du résultat avec des valeurs et un environnement social proches de ceux de la vieille Europe.
NB : vous pouvez retrouver l’auteur sur son site www.reconnaissanceautravail.com
Résumé de l’ouvrage :
Selon l’auteur, la reconnaissance au travail est un élément clé de l’identité et de la santé des personnes, ainsi que de la croissance, de la transformation et de la performance économique. Il s’agit d’une forte demande des salariés et le manque de reconnaissance est le deuxième facteur (après la surcharge de travail) cité comme cause de détresse (selon une étude réalisée par l’Université de Laval). Pourtant « la reconnaissance ne fait pas encore partie de l’ADN des entreprises ». La culture du contrôle et de la sanction prédomine encore. Comme le dit très justement un DRH, « la reconnaissance, c’est l’accusé de réception dont nous avons tous besoin pour continuer à envoyer nos messages ».
L’auteur présente ensuite les résultats d’une enquête menée auprès de DG et de DRH de 55 entreprises (totalisant plus de 1,5 millions de salariés) pour évaluer l’importance accordée à la reconnaissance au travail, les pratiques présentes et les obstacles rencontrés. En voici une synthèse :
La priorité est donnée à la reconnaissance des pratiques de travail, que ce soit à travers les compétences, l’expertise ou les qualités personnelles des salariés. Vient ensuite la reconnaissance des résultats avec la qualité du travail et les exploits professionnels et, de façon beaucoup moins marquée, l’utilité du travail. Suit immédiatement la reconnaissance de l’investissement dans le travail, que ce soit celle des efforts fournis ou d’une contribution exceptionnelle. Enfin, la reconnaissance existentielle reconnaît assez largement les attitudes positives mais beaucoup moins les idées que peuvent avoir les salariés.
En matière de pratiques, c’est la reconnaissance autour de l’écoute des collaborateurs avant de prendre une décision, la participation à un groupe de résolution de problèmes ou à un groupe projet, même si l’accessibilité à des outils de travail appropriés est à un niveau préoccupant. La reconnaissance relationnelle arrive en second à travers des remerciements verbaux, ou le soutien ponctuel en cas de difficultés personnelle.
Elle est suivie par la reconnaissance matérielle dans laquelle la reconnaissance matérielle pulvérise les records de popularité.
Enfin, bonne dernière, la reconnaissance sociale valorise le salarié lors de réunions, de cérémonies, de reconnaissance, de tableau d’honneur ou de palmarès à travers des activités sociales.
Conclusion : il existe donc un fort déficit de reconnaissance sociale et existentielle.
Dans un deuxième partie, l’auteur indique comment faire de la reconnaissance une vraie pratique managériale. Il commence par pointer les freins culturels, fait le lien entre reconnaissance, motivation et sens (cf. pyramide de Maslow), mais également entre motivation, bien-être des salariés et performance économique des entreprises. Il invite les dirigeants et managers à « latiniser les pratiques américaines » bien plus développées.
Parmi les conseils donnés, Christophe Laval indique qu’il faut savoir doser entre 4 niveaux de reconnaissance (politesse et respect des autres, reconnaissance quotidienne, reconnaissance informelle et reconnaissance solennelle) et indique des actions concrètes.
Et de conclure sur la nécessité de faire de la reconnaissance un objectif opérationnel au même titre que n’importe quel autre objectif business. « Nous sommes très loin de la psychologie et en plein cœur de préoccupations du business ».

On vous remercie de ce partage.
Bon courage pour la suite.
Offre d’emploi à Laval